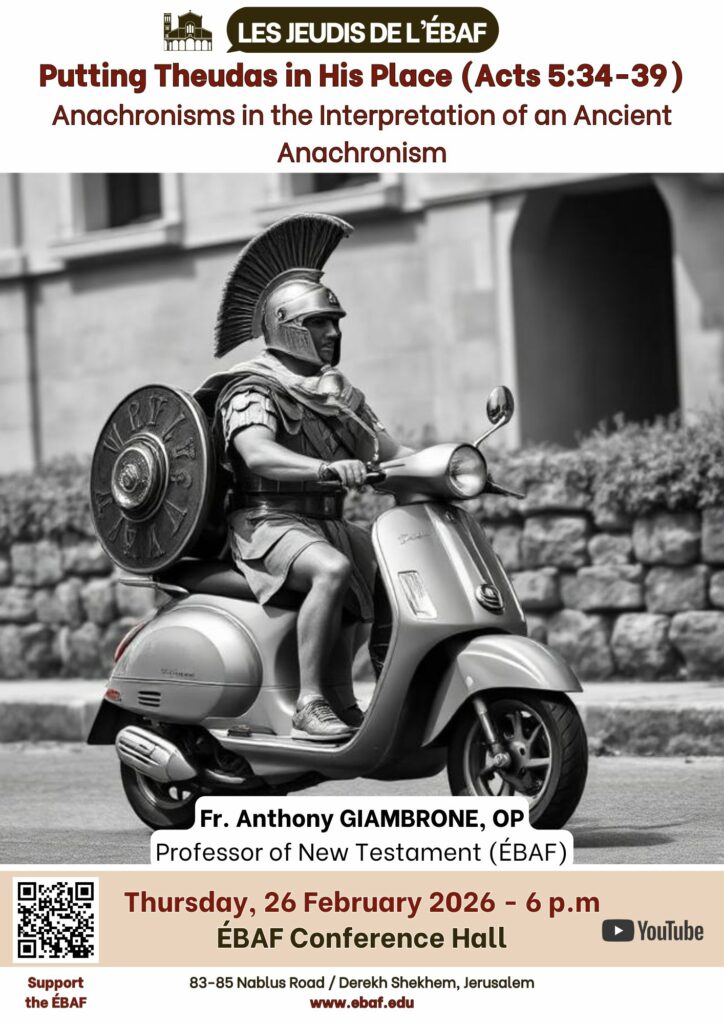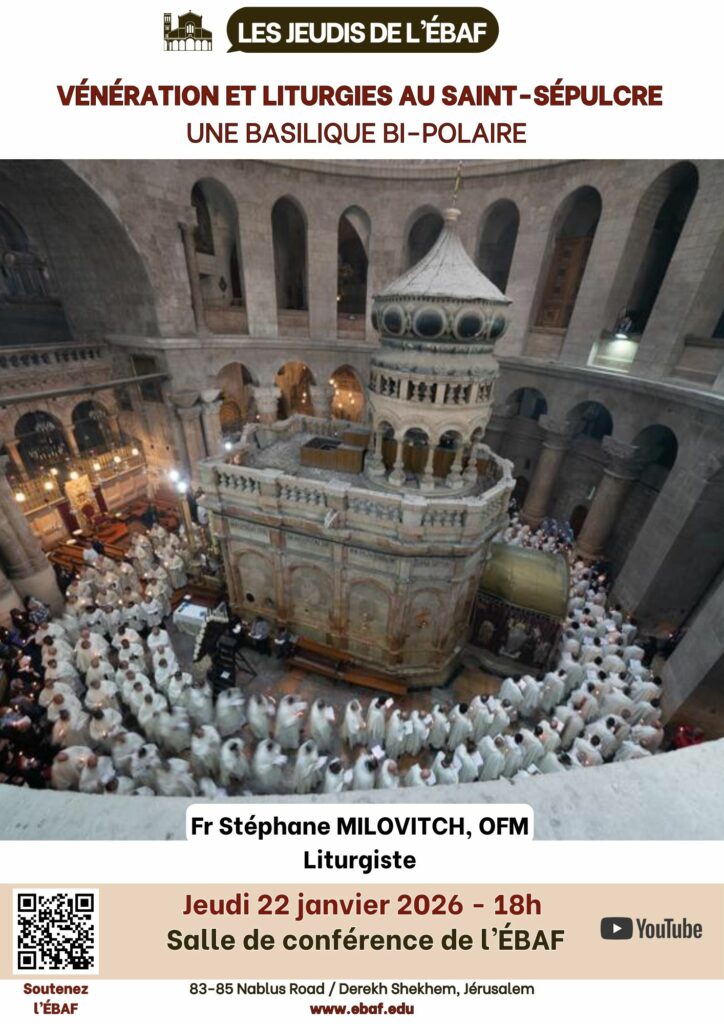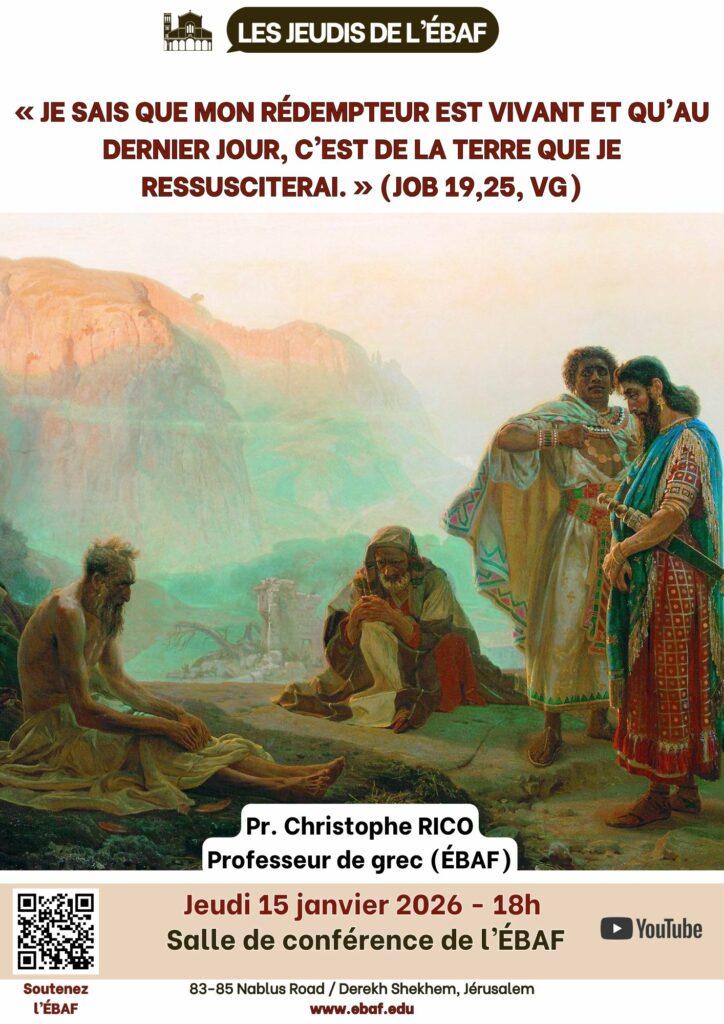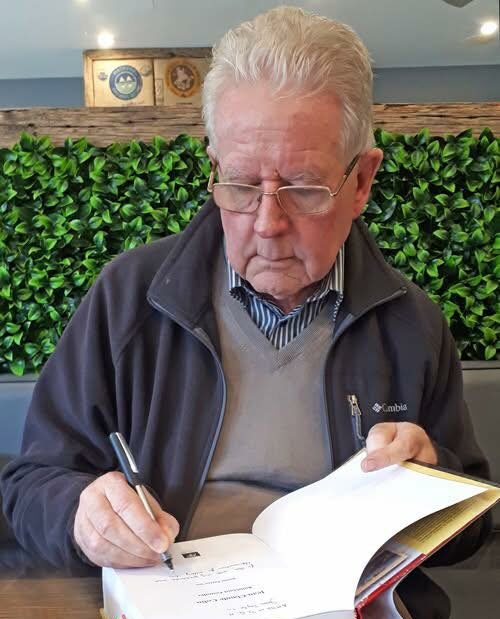Célébrer Noël en Terre Sainte
C’est dans un climat de recueillement, de joie, de fraternité et, cette année, d’espérance que les frères, étudiants et chercheurs de l’École biblique et archéologique française ont célébré les fêtes de la Nativité.
Alors que les lectures du temps de l’Avent redisaient l’attente impatiente de la naissance, la généalogie du Christ est venue proclamer dans la joie le mystère de l’Incarnation du Christ. En ce 24 décembre 2025, l’encensement de la figure de l’Enfant Jésus déposé dans la crèche par le fr. Bernard Ntamak-Songé est venu réaffirmer le lien entre les éléments de notre vie quotidienne et le Salut du monde.
La nuit du 24 décembre a été inaugurée par une liturgie solennelle, avec les vêpres chantées, suivies de la messe de la Nuit de Noël, animée par la chorale. Au début de la célébration, présidée par le frère Bernard Ntamak-Songé, la crèche a été inaugurée par le geste symbolique du dépôt de l’Enfant Jésus, rappelant le mystère central de l’Incarnation. À l’issue de la messe, un temps de convivialité a permis aux fidèles de se retrouver et d’échanger autour d’un chocolat chaud, prolongeant la joie liturgique dans une atmosphère fraternelle.

Aux environs de minuit, un groupe s’est rendu à Bethléem pour participer à une nouvelle célébration dans la basilique de la Nativité. L’accès à la Grotte de la Nativité a offert à chacun la possibilité de vivre un moment de prière particulièrement fort, simple et profondément marquant, au plus près du lieu traditionnel de la naissance du Christ.
Le jour de Noël, la fête s’est poursuivie avec la célébration de la messe au cœur de la journée, suivie d’un repas partagé dans la joie. Ces temps de table et de rencontre, essentiels à la vie communautaire, ont permis de vivre concrètement la dimension fraternelle de la fête. En soirée, des chants de Noël ont accompagné la récréation, dans un esprit de simplicité, sans oublier la conscience aiguë que la paix demeure fragile et inégalement vécue dans le monde, et tout particulièrement dans la région.
Le 26 décembre, à l’occasion de la fête de saint Étienne, a eu lieu à l’École biblique et archéologique française la messe consulaire annuelle, un moment fort du calendrier liturgique et ecclésial à Jérusalem. Cette célébration a rassemblé de nombreux fidèles, parmi lesquels des habitants de la ville et des visiteurs de passage, ainsi que le Consul général de France à Jérusalem, M. Nicolas Kassianides, représentant officiel de la République française dans la région.

Présidée par le frère Stanisław Gurgul, nouveau prieur de la communauté, et entourée de nombreux prêtres, la messe du protomartyr Étienne, portée par le chant de la chorale, a offert un temps de prière solennel et d’unité. À l’issue de la célébration, un temps de convivialité a réuni fidèles et participants devant l’église, avant que les festivités ne se prolongent au réfectoire. M. Kassianides s’est alors joint à la communauté pour le repas festif et a adressé quelques mots, dans une atmosphère joyeuse.
Ces célébrations de Noël à Jérusalem ont été l’occasion de rendre grâce pour le don de la foi, pour la beauté de la liturgie vécue sur les Lieux saints, et pour la communion fraternelle qui unit la communauté de l’ÉBAF, les fidèles de la Ville Sainte et les visiteurs de passage. Dans un contexte marqué par l’incertitude, elles ont rappelé la source de l’espérance chrétienne : la naissance du Prince de la paix.