Le 20 juin 2024, Frère Bernard Ntamak, bibliothécaire en chef de l’École biblique et archéologique française de Jérusalem, a pris la parole lors du colloque des Journées Bibliothèques d’Orient à Paris. Cet événement a rassemblé des chercheurs et des institutions de conservation venant de France, Syrie, Liban, Irak, Turquie, Égypte, Israël et Palestine.
Fondée en 1890, la bibliothèque de l’Ébaf est l’une des bibliothèques les plus prestigieuses au monde dans les domaines de l’exégèse biblique et de l’archéologie du Proche-Orient. Elle est également reconnue pour ses collections sur les langues, l’histoire et la littérature des peuples du Proche-Orient ancien.
La bibliothèque de l’Ébaf conserve près de 12 300 volumes offrant des études classiques, spécialisées et rares sur la Terre Sainte. Ces collections couvrent divers secteurs de recherche, notamment la topographie, l’archéologie, la géographie, l’histoire, la sociologie, la linguistique, les études littéraires, la recherche biblique, ainsi que les récits de voyages de pèlerins, les inscriptions, les manuscrits, les estampes et l’épigraphie en général.
Frère Bernard Ntamak a souligné l’importance cruciale du travail de numérisation à l’Ébaf. Ce projet vise à protéger et diffuser le patrimoine culturel et intellectuel de la bibliothèque. Grâce au financement de la fondation Mellon, plusieurs volumes précieux ont été numérisés ces deux dernières années pour le compte de Bibliothèques d’Orient.
Quelques études de nos collections sur la Terre Sainte : des livres et des revues :
Album de Terre Sainte (Das Heilige Land) par auteur inconnu, [1898 ?]
Album photo de la Vieille ville de Jérusalem et de la Terre Sainte. Les photos datent probablement de 1898, compte tenu de l’architecture de la basilique de Saint Étienne, mais certaines photos sont plus anciennes (1864).
Atlas de Géographie Générale de la Palestine : historique, politique, économique Par Zadig Khanzadian. Paris : Les Éditions Géographiques Khanzadian, 1932. Paris Atlas de la Palestine par le cartographe arménien Zadig Khanzadian, avec 134 cartes anciennes très rares (numérotées de 1 à 135), pour la plupart en couleurs, et deux pages de titre illustrées. Imprimé sur papier épais de qualité (feuilles séparées, pliées en deux) Ces cartes présentent la géographie historique, politique et économique de la Palestine : les cartes 1-99 présentent sa géographie historique – histoire ancienne, médiévale et moderne ; les cartes 100-127, sa géographie politique sous le mandat britannique – répartition des juifs et populations arabes, peuplement sioniste urbain, éducation, santé, démographie ; les cartes 128-135, sa géographie économique – ressources naturelles, agriculture, pêche, industrie et finance, communication, routes, trains et ports, tourisme et industrie.Cet important atlas a été utilisé par la commission de l’ONU chargée du partage de la Palestine. Au début de l’atlas, se trouve une lettre de l’auteur au Secrétaire général de la Ligue des Nations, Eric Drummond, expliquant les raisons de la fabrication de cet atlas – les sanglantes émeutes palestiniennes de 1929.Les feuillets sont réunis dans un portfolio de cuir, orné d’un relief artistique. Cet ouvrage est d’une valeur inestimable.
Le voyage de la Terre Sainte, contenant une véritable description des lieux plus considérables que N. S. a sanctifié de sa présence, prédications, miracles et souffrances. Par Jean Doubdan. Paris : François Clousier dans la Cour du Palais prés l’Hostel de M. le premier Président, 1657.1 vol. (743 p.); ill. en noir, 23 cm. Ce livre est la description du voyage de Jean Doubdan, Maître de chapelle de la collégiale Sainte Denis près de Paris, en Terre Sainte en l’année 1652. Le livre, contrairement à ses contemporains, ne se concentre pas uniquement sur les descriptions des lieux et des réalités rencontrées au cours du voyage mais s’interroge sur la nature de la littérature de pèlerinage. (Numérisé en 2024).
Geografia, cioè descrittione univesale della terra Cl. Tolomeo / Gio. Ant. Magini / Leonardo Cernoti Venice: Gio. Battista & Giorgio Galignani Fratelli, 1598 2 volumes, in-4 Il s’agit de la première édition de la traduction italienne de Leonardo Cernoti de la Géographie de Claudius Ptolémée basée sur l’édition latine de 1596 de Giovanni Antonio Magini, publiée par Giovanni Battista et Giorgio Galignani en 1597-1598. Les belles cartes gravées sont attribuées à Girolamo Porro et elles ont également été utilisées dans la traduction de Magini de 1596. Il est illustré de plusieurs bois gravés dans le texte, de deux vignettes de titre gravées, une pleine page et 63 cartes gravées à demi-page, dont 27 cartes de Ptolémée et 37 cartes «modernes», dont 4 mondiales, 1 carte d’Amérique, 32 cartes européennes, 6 cartes d’Afrique et 21 cartes d’Asie. Mentionnons les trois premières cartes du monde «modernes», les premières cartes pleines feuilles montrant une configuration classique du monde de la fin du XVIe siècle. Ce qui nous intéresse est une carte de la Palestine assez précise qui indique les noms de différentes contrées aujourd’hui disparues (pages 175-178). “C’est le mérite de l’artiste que tant de détails ont été représentés avec une telle finesse et clarté (…) Cette petite carte Mercator-Porro est un objet de collection intéressant, d’autant plus que la plus grande carte du monde Mercator se fait de plus en plus rare”. La présentation de la Palestine au nord (Syrie, Samarie et Galilée) comme étant la Terre Sainte est unique.
Hébron. Le Haram El-Khalîl Sépulture des Patriarches Par le révérend Père Vincent, dominicain de l’école biblique et archéologique française de Jérusalem, le Capitaine Mackay et avec la collaboration du révérend Père Abel, dominicain de l’Ebaf présentent les tombeaux des Patriaches à Hébron en 1923 aux éditions Ernest Leroux à Paris. Cet ouvrage est un original qui fait autorité en la matière. 2 Vols (Texte et planches). —» Nous pouvons ajouter les 06 volumes de l’ouvrage intitulé : Coutumes Palestiniennes. Naplouse et son district par le révérend père dominicain Jaussen en 1927 publié par La Librairie Orientaliste Paul Geuthner à Paris.
Les collections de l’Ébaf sur la Terre Sainte représentent une richesse inestimable. La numérisation et la restauration de ces collections sont essentielles pour leur protection et leur diffusion. Le projet de numérisation, soutenu par la fondation Mellon, est une initiative primordiale à encourager et à renforcer pour préserver ce patrimoine.
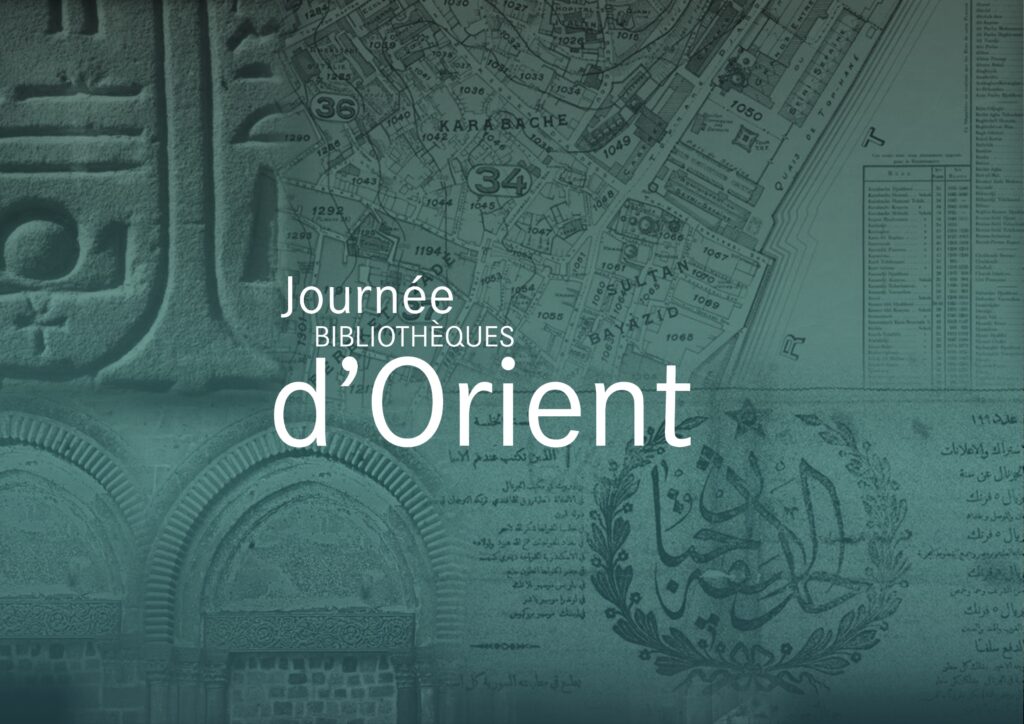



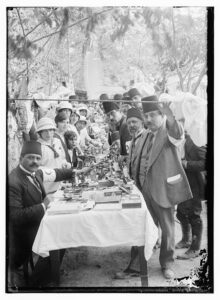

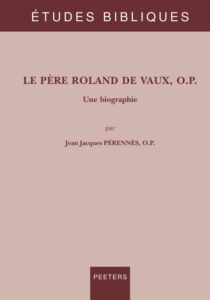

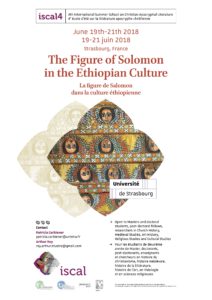 * Du 19 au 21 juin, à Strasbourg : colloque “Salomon dans la culture éthiopienne”
* Du 19 au 21 juin, à Strasbourg : colloque “Salomon dans la culture éthiopienne”